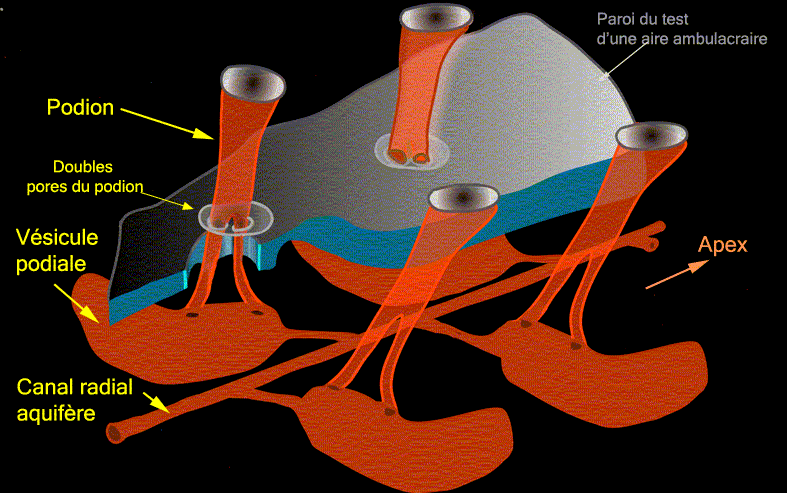Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

jjnom
Membre-
Compteur de contenus
3086 -
Inscription
-
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Blogs
Boutique
Tout ce qui a été posté par jjnom
-
Bivalves - Brachiopodes - etc. - Callovien inférieur - Jura méridional
jjnom a répondu à un sujet de yomgui dans Demandes d' identification de fossiles
En considérant que les exemplaires sortent tous du Callovien inférieur: En haut: Aulacothyris pala Puis Aromasithyris subcaniculata à cause de la forme subpentagonale. D. Dorsoplicata a une forme plus ovale. Pour la Rhynchonelle: probablement Rhynchonelloidella fuerstenbergensis. -
Voici quelques photos qui sont toutes relatives à l'histoire géologique de la Belgique mais aussi à l'histoire et au patrimoine des Hauts de France. Keksé? Ouksé? C'est quoi le film? Photos 1 et 2 Photo 3 (Matériel déplacé) Photo 4 (Matériel déplacé) Ceux qui pensent à quilles et boule sont éliminés. Photo 5 Photo 6
-
Bivalves - Brachiopodes - etc. - Callovien inférieur - Jura méridional
jjnom a répondu à un sujet de yomgui dans Demandes d' identification de fossiles
Ouais, sans une vue du côté du crochet, pas jouable. -
Demande de détermination des microfossiles
jjnom a répondu à un sujet de Hulyaben dans Demandes d' identification de fossiles
1 Foraminifères miliolidé 2 et 3 Bryozoaires (Cheilostome multisérié pour 3) 4 et 11 Foraminifères rotaliidés 5 et 6 Gastéropodes 7 et 8 Bivalves (8 type Cardium) 9 et 10 Ostracodes possible. -
Grenat : info, discussion et photos de grenats
jjnom a répondu à un sujet de agcambrai dans Forum Minéraux et Minéralogie
Salut Serge. La paragénése minérale indiquée est celle donnée par différents papiers qui concernent le site. Et ces papiers ne donnent guère d'infos sur la texture et l'assemblage de la mésostase. Je sais bien que ça ne fait pas très vert. La bande plus colorée prêche pour omphacite et les couronnes autour des grenats aussi. Maintenant, une lame serait plus convaincante mais là, je n'ai pas. Difficile d'exclure à priori l'idée que l'omphacite n'a pas bougé elle aussi. -
Grenat : info, discussion et photos de grenats
jjnom a répondu à un sujet de agcambrai dans Forum Minéraux et Minéralogie
Retour en Autriche, du côté de Langenfeld, toujours dans le Tyrol, toujours dans l’Austroalpin. Sous le Gamskogel, accessible depuis Gries, se trouve un complexe comprenant des amphibolites, des éclogites avec aussi quelques gabbros et préridotites. Les éclogites du coin, vont en rappeler d’autres, bien françaises. A l'affeurement, depuis 1,5/2m de hauteur, rien de bien notable mis à part ces grains rouges rouilles sur fond gris. En cassure fraiche, apparaissent des grains parfois rouges, parfois noirs sur un fond gris légèrement vert. Après sciage, on comprend que le noir de certains grains n’est en fait qu'un « enrobage » des grains rouges. Le fond gris-vert montre une traînée plus olivâtre. Sur le plan minéralogique, on a principalement des grenats, de l’omphacite, du disthène et de la zoisite. En outre, au contact entre le fond gris vert et les grenats est intervenue une réaction Omphacite + grenat = hornblende + plagioclase. C’est cette hornblende qui donne la couleur sombre à la couronne réactionnelle qui enrobe les grenats. C’est la signature de la rétromorphose qui a déstabilisé les grenats quand les éclogites se sont retrouvées dans les conditions du faciès amphibolite. Toute la formation est issue du métamorphisme d’un gabbro à olivine ou d’une troctolite. Il se serait mis en place vers 520-530 Ma. Il a ensuite été repris durant le cycle hercynien vers 350-360Ma. Les amphibolites ont été générées à une température de 650°C et une pression de 7 kb (20 km de profondeur). Les éclogites se sont formées bien plus bas : 730-750 °C et 27-28 kb (85 km de profondeur)! De quoi y voir la trace d’une subduction. Exhumation entre 340 et 330 Ma puis lent refroidissement : température estimée encore du côté de 300°C vers 270 Ma. Là-dessus, un métamorphisme alpin en a rajouté une petite louche au Crétacé. -
Avant que la porte ne se referme, quelques infos trouvées dans la biblio du web: 1) La formation de slicks pédo supposerait des sols ayant au moins 30% d'argile et une fraction argileuse composée principalement de smectites. 2) Dans les sols à slicks pédo fossiles du Carbonifère, les smectites n'existent plus et ont été transformées par la diagénèse en illite et chlorite. Apparemment, cette transformation conserve les slicks mais elle suppose aussi une élévation de température vers les 100°C liée à un enfouissement marqué. Pas trouvé d'exemples de slicks conservés dans une transformation smectite vers kaolinite mais je suis peut-être passé à côté. 3) Il existe une 3° sorte de slicks pouvant exister dans les formations argileuses: les slickensides hydroplastiques résultats de phénomènes de slump + compaction.
-
Roche plutonique avec couche de lave? Prov. Corse;
jjnom a répondu à un sujet de sirob dans Roche et pétrographie
La fusion du granite sous 1 bar, ça doit aller plutôt du côté de 1000°C. Non? Pour ce qui est des murs vitrifiés, style ceux de France ou d'Ecosse, je crois qu'on peut oublier. C'est semble t'il très lié aux Celtes qui, jusqu'aux dernières nouvelles, ne sont jamais allés en Corse et je n'ai pas trouvé de mention de murs vitrifiés en Corse. Mais là, on n'est même pas certain qu'il s'agisse d'une fusion du granite. Le Castellu lui-même serait du 13° siècle. -
TRES prévisible, l'intervention avant que Quat ne réponde. Façon de tuer la discussion. J'espère encore qu'un grand garçon de 56 ans passera outre la boffitude suggérée.
-
Fossile ou minéral (ou les deux)
jjnom a répondu à un sujet de SACHA16 dans Demandes d' identification de fossiles
Quand on voit ça Pas de pb pour dire tige d'encrine. Les articles avec les crénelures + la calcite en monocristal: OK Mais les disques très aplatis, qui font dans les 2,5 cm de diamètre? La base du calice? -
Fossile ou minéral (ou les deux)
jjnom a répondu à un sujet de SACHA16 dans Demandes d' identification de fossiles
-
Ben, pas encore trouvé les réponses à mes interrogations. OK. Pourquoi pas mais quid des proportions de l'un et de l'autre? Donc, il y aurait des sols composés de 70% de kaolinite qui pourraient développer des slicks pédo? Ben, ça mériterait d'être développé. Toutes les publis trouvées sur le net mettent en relation les slicks avec les smectites. Certains sites n'hésitent pas à intégrer smectite dans la définition de vertisol. Et c'est bien compréhensible car les surfaces spécifiques sont de l'ordre de 4-10 m2/g pour la kaolinite et 150-500 m2/g pour les smectites (mesures par absorption d'eau). Soit des capacités potentielles de gonflement (et rétraction) 40 à 50 fois supérieures pour les smectites. Question déjà posée: Comment s'effectue la transformation smectite vers kaolinite dans un paléovertisol? Conséquences? Notamment sur les volumes et la conservation des slicks.
-
Grenat : info, discussion et photos de grenats
jjnom a répondu à un sujet de agcambrai dans Forum Minéraux et Minéralogie
Ben oui, une dérive étiquettaire. Apparemment, plus on va vers le cercle arctique et plus il est difficile d'obtenir des infos. Si ça intéresse, les grenats sur biotite viendrait d'un secteur qui comporte essentiellement de l'Archéen (2500-2100 Ma) repris et granitisé à l'occasion de l'orogénèse svécofennienne vers 1800-1900 Ma. Rien trouvé sur les conditions du métamorphisme. Avec biotite et grenat, on est certainement passé dans les amphibolites avec des T de 450-500 °C au moins mais à part çà, je n'ai pas d'autres éléments pour le moment. Ah, un détail: Hamaroy est le nom d'une région. Tiltvika est le nom d'une baie. Ne cherchez pas le nom d'un village, il n'y en a pas. Pas de route non plus d'ailleurs. Doit y avoir beaucoup plus d'oiseaux marins que de bipèdes terrestres par là-bas. -
Grenat : info, discussion et photos de grenats
jjnom a répondu à un sujet de agcambrai dans Forum Minéraux et Minéralogie
Merci, grenadof. C'est très ressemblant, effectivement. Et OK aussi pour les années 60-70. En fait de changement de continent, j'étais toujours en Norvège, sans le savoir. -
Grenat : info, discussion et photos de grenats
jjnom a répondu à un sujet de agcambrai dans Forum Minéraux et Minéralogie
Changement de continent. Enfin, je le suppose, car c'est un cadeau qui m'a été fait il y a bien longtemps. Ce serait des almandins en provenance du Minas Gerais au Brésil. La matrice semble être un assemblage de hornblende et de mica noir. Si quelqu'un pouvait confirmer et peut-être même être plus précis quant au lieu d'origine, ça m'aiderait probablement à retrouver l'histoire géologique de l'échantillon. Merci. -
Fossile ou empreinte ?
jjnom a répondu à un sujet de AstrorilliM dans Demandes d' identification de fossiles
Ca pourrait avoir été une écorce de Sigillaire mais tellement recristallisée et déformée que ça en devient méconnaissable et que je ne conseillerai pas de la conserver. -
Grenat : info, discussion et photos de grenats
jjnom a répondu à un sujet de agcambrai dans Forum Minéraux et Minéralogie
Allez, on continue la ballade. On retournera en Autriche plus tard. Bonjour la Norvège du côté de Vanylven. Ces quelques cm3 de roche ont une histoire longue et compliquée. Les grenats sont des pyropes et qui dit pyrope dit Magnésium. De fait, ces grenats sont inclus dans une pyroxénite. Et les pyroxénites du coin sont incluses dans des péridotites qui sont activement exploitées pour l’industrie de la sidérurgie car elles ont la particularité d’être particulièrement riches en magnésium (au passage : source possible pour les komatiites). En fait cet échantillon est un vrai groom d’ascenseur. Certains âges absolus le font remonter à 2700-3100 Ma et il se serait formé par fusion transitoire des péridotites. Il aurait connu des températures de 1300-1500°C et des pressions qui seraient celles qu’on rencontrerait dans le manteau vers 200 km de profondeur. Un bout de manteau datant de l’Archéen. Il a été ensuite incorporé à l’écorce terrestre lors de l’orogène Gothien vers 1600 Ma (les gneiss qui l’accompagnent sont de cet âge). Il a vu passer ensuite l’orogène sveconorvégien (950 Ma) sans broncher. Vers 400-420 Ma, quand le continent Baltica est entré en collision avec la Laurentia pour former la chaîne calédonienne, il est redescendu par subduction dans le manteau vers 120 km de profondeur avant d’être ensuite exhumé et envoyé à l'affleurement. Faut avoir une sacré santé, hein? -
Fossile végétal.... bambou !?..
jjnom a répondu à un sujet de josifa85 dans Demandes d' identification de fossiles
Bélemnite. -
Ben, si les silex du coin fossilisent les tissus mous, on n'a pas fini de se poser des questions. En outre, ça pose la question du processus de fossilisation qui a du démarrer très tôt.
-
En fin de compte, je vais dire oursin. La pseudo costulation pourrait bien correspondre à l'empreinte des plaques de la coquille. Et la double rangée de granules, proche de la surface de cette coquille pourrait bien correspondre aux ampoules podiales du système aquifère . Bien la première fois que je vois un système aquifère fossilisé. Y a un début à tout.
-
Grenat : info, discussion et photos de grenats
jjnom a répondu à un sujet de agcambrai dans Forum Minéraux et Minéralogie
Quelques infos autour du Granatenkogel et du contexte du site. Il y a de nombreuses années, en vacances dans le Tyrol et à force de voir des cristaux bien facettés de 10 cm de diamètre dans les Stube (les auberges de montagne du secteur), il a bien fallu que j'aille me rendre compte. Je ne suis pas allé, faute de temps et d'équipement, jusqu'au saint des saints, le Granatenwand mais la ballade était quand même intéressante. Le Granatenkogel est à la frontière entre Autriche et Italie. L'accès s'effectue par la station d'Obergurgl. Depuis le site d'arrivée des remonte-pentes, un chemin se déroule sur une croupe entre 2 torrents alimentés par des glaciers. Coin bien sympa même en simple touriste. Sur le chemin même apparaissent rapidement les premiers grenats. Pas bien gros, pris dans un micaschiste avec des surfaces gris clair très réfléchissantes: de la séricite. On est dans le faciès métamorphique des schistes verts. La roche à la base devait être une pélite. Une section perpendiculaire à la foliation montre les lits de quartz et les lits de mica. Les grenats sont toujours associés au mica qui a fourni le fer nécessaire à la formation des grenats almandins. Mais n'espérez pas pour autant les dégager facilement car ils sont aussi bien maintenus par les bords des lits de quartz. Descente vers le torrent sur la gauche de la photo ci-dessus La roche s'est chargée en longues aiguilles noires: de la hornblende. La séricite est encore abondante et les grenats bien présents. On est passé dans le faciès amphibolite et la hornblende devient envahissante au point que les autres minéraux (même les grenats habituellement bien repérables) deviennent accessoires. La taille des cristaux de hornblende augmente sensiblement tant en longueur (une dizaine de cm) qu'en largeur. A gauche: brut. A droite, après sciage Mais bon, on peut trouver de jolis assemblages. Remarquer sur cette section la disposition en bande des almandins. Remarquer aussi un minéral blanc à proximité de certains grenats. Ce pourrait être du feldspath plagioclase indice d'une déstabilisation de ces cristaux par rétromorphose. Pas facile à casser l'amphibolite, alors, comme on n'a pas bien le temps, on gratte les dépôts dans le lit du torrent: La roche à la base de l'amphibolite devait être une roche magmatique basique. Elle a été porté à une pression de 8 à 9 kb et à une température qui s'est approchée des 600°. Ce qui correspondrait à une profondeur de 30 à 35 km. Dans le secteur, d'autres roches sont allées encore plus bas, puisque le domaine des éclogites a été atteint. Mais ce sera pour une autre fois -
Roche plutonique avec couche de lave? Prov. Corse;
jjnom a répondu à un sujet de sirob dans Roche et pétrographie
Cette couche sombre aurait-elle une odeur particulière? Comment réagit-elle quand on la chauffe? -
Piégé par les plages vertes, hein? Faut dire qu'on trouve + facilement un gabbro euphotide qu'un gabbro éclogitisé. C'est un très chouette échantillon. Il résume l'histoire de l'océan alpin. De la formation du plancher à son exhumation en passant par la subduction. @TicoSuizo Si tu as d'autres exemplaires, ça m'intéresse.
-
En fait, c'est un métagabbro qui a été sérieusement métamorphisé puisqu'il est entré dans le domaine des éclogites (approx 90 km de profondeur). Les plages vertes seraient de l'omphacite.Puis ensuite rétromorphosé. A l'omphacite s'ajoute des feldspaths plagioclases, de l'olivine, des clinopyroxènes, du talc... Le grenat est discret voire absent. Ceci d'après cet article très détaillé: https://academic.oup.com/petrology/article/50/8/1405/1402629/The-Eclogite-facies-Allalin-Gabbro-of-the-Zermatt
-
Quand on zoome sur les 2 rangées de granules, on réalise que la coquille a laissé l'empreinte d'une costulation très serrée qui fait penser à celle d'un possible bivalve ou d'une rhynchonelle. Des Crania possèdent une costulation marquée mais moins serrée et moins régulière. En outre (estimation à partir de la largeur du pouce), la bestiole doit atteindre les 2 cm de diamètre. Ca me semble gigantesque pour un Crania.