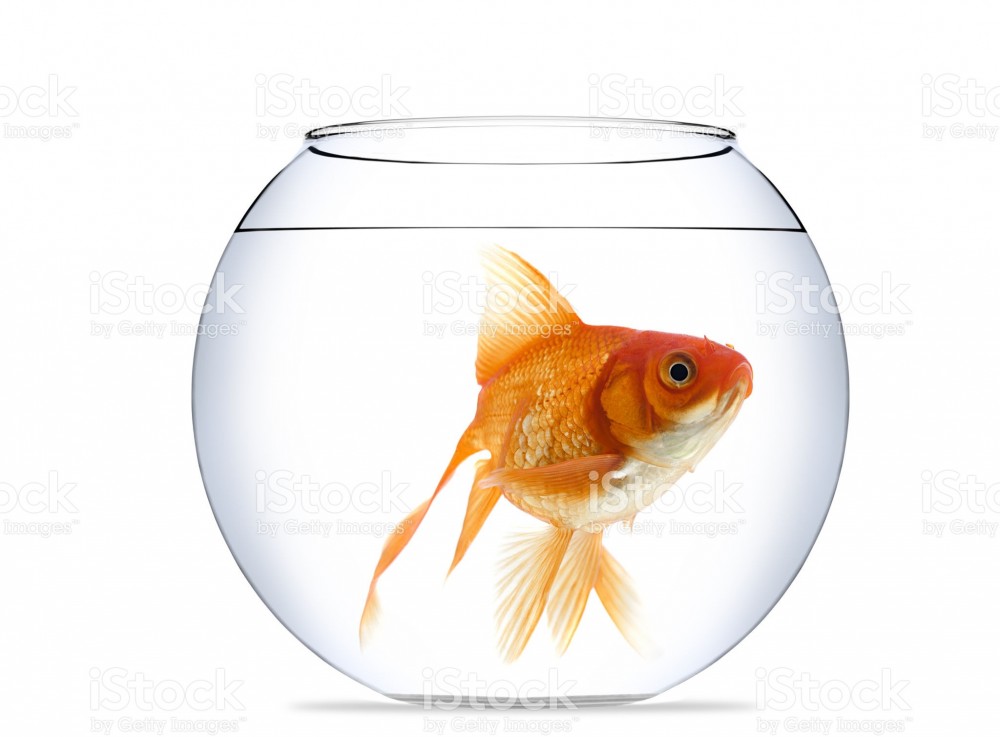Bon, je vais me la péter une dernière fois, enfin j’espère...
Mais un petit résumé s’impose.
Du point de vue de la méthodologie, je retiens surtout les analyses chimiques, je ne comprends rien à vos histoires de lames minces.
Les analyses chimiques présentées par romt20 sont remarquables : non seulement elles révèlent la nature des cailloux mais en plus elles nous conduisent jusqu’à l’usine qui les a produits.
La chimie, ce n’est pas juste la présence de tel ou tel élément. La façon dont ces éléments sont associés en dit beaucoup plus.
De nombreux métaux sont présents, ils peuvent rester à l’état métallique ou se combiner avec le soufre, l’oxygène, le chlore...
Ici, les deux paramètres les plus importants sont les potentiels chimiques en oxygène et en soufre qui permettent de dire si un métal s’associera plutôt au soufre, plutôt à l’oxygène ou restera libre.
On peut situer ces potentiels à partir des phases en présence et remonter aux propriétés du « magma » qui a donné naissance à ces cailloux.
Ces potentiels sont exactement ceux que l’on aurait choisis pour extraire un maximum de plomb.
Ils expliquent quasiment toute la chimie de ces cailloux. Quand de surcroît on voit la ressemblance (aspect, densité… ) avec les scories de Pontgibaud, il est impossible de ne pas y voir des résidus d’extraction de plomb. Il ne restait plus qu’à trouver d’où viennent le chlore et l’antimoine.
Ci-dessous une vue de l’ancienne usine de Couëron sur l’estuaire de la Loire avec la tour à plomb qui servait à fabriquer les plombs de chasse. On y trouvait tous les ingrédients :
- une fonderie de plomb pour les scories,
- l’antimoine dans les plombs de chasse (voir la remarque de jjnom)
- les barges pour amener le minerai et un peu d’eau salée…