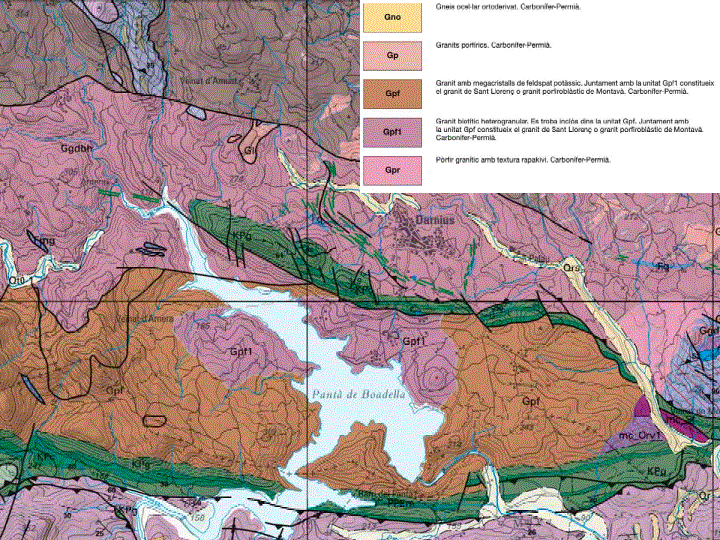Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |
-
Compteur de contenus
1584 -
Inscription
-
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Blogs
Boutique
Tout ce qui a été posté par Quaternaire
-

affleurement de conglomérat de quartz
Quaternaire a répondu à un sujet de AlainR dans Forum Géologie
+1 Oui kayou, c'est exactement ce à quoi je faisais allusion, et cela me semble une bonne hypothèse puisque c'est dans un massif de granite d'âge carbonifere-permien. Donc il y de forte chance que l'on est des residus des formations sedimentaires de dementellement de ce massif au permo-trias. -

affleurement de conglomérat de quartz
Quaternaire a répondu à un sujet de AlainR dans Forum Géologie
bonne remarque, on peu en effet douter si on y regarde a 2 fois -
Tu peux toujours nous mettre un extrait de la carte géologique en montrant la faille en question histoire de lancer une dynamique de discussion sur ce sujet
-

affleurement de conglomérat de quartz
Quaternaire a répondu à un sujet de AlainR dans Forum Géologie
D'accord avec Next, c'est pas du quaternaire cela ..je dis cela au filling. ca a la tronche d'un tres vieux conglomerat permo-triasique -

minéral vert pâle dans granite
Quaternaire a répondu à un sujet de oliv62 dans Demandes d' identification de minéraux
Vous etes sûr que c'est minéral? -

Les Latérites, les paléosols et la Bauxite de la Chaîne des Alpilles
Quaternaire a répondu à un sujet de Next50MY dans Forum Géologie
C'est plus simple de tout mettre ici: ru, ruLha. Barrémien. Calcaires argileux, calcaires à silex. Dans la région de Châteaurenard—Caumont le Barrémien inférieur daté par Emericiceras sp. et Torcapella sp. est représenté par des calcaires fins ( r u lh a) ou des calcaires argileux à hard-grounds fréquents (ru). Les calcaires bioclastiques de Noves sont attribués aux mêmes niveaux stratigraphiques. nAI. Bauxite. Cette roche (c'est un paleosol plus qu'une roche) , signalée près des Baux comme « alumine hydratée » par Berthier en 1821, fut ainsi nommée par Dufrénoy en 1837 et analysée plus précisément par Sainte-Claire-Deville en 1861, qui y découvrit, en particulier, du vanadium. Sur le flanc septentrional des Alpilles, les affleurements sont très discontinus, sous forme de poches dans un mur urgonien karstifié ; encore s'agit-il surtout de « pseudobauxite » constituée de kaolinite et d'hématite. Dans le synclinal des Baux le minerai, exploité aujourd'hui en souterrains, constitue des gisements dépassant parfois vingt mètres d'épaisseur, avec un mur de calcaire blanc urgonien au Sud-Est des Baux, de calcaire gris hauterivien ailleurs. Dans ces gîtes s'observent de très nombreuses variations verticales et latérales. Macroscopiquement, le matériau rouge, avec ou sans pisolithes d'hématite et goethite, peut passer à des bauxites « flammées », « tigrées » ou « truitées », en partie décolorées, voire à des bauxites verdâtres ou blanches. La texture de la roche est souvent celle d'un poudingue ou d'une brèche, prouvant un transport par l'eau. Minéralogiquement boehmite et gibbsite sont associées en toutes proportions à de la kaolinite ; cette argile, importune pour l'extraction de l'alumine, existe parfois seule, associée à des oxydes de fer, à l'exclusion des hydrates d'alumine : c'est la « pseudobauxite », fréquente surtout près du mur des gîtes. La teneur en oxydes de fer, hématite plus ou moins altérée en goethite, est très variable, jusqu'à 25 %. S'y ajoutent 2 à 3 % d'oxydes de titane, sous forme de rutile et surtout d'anatase, un peu de vanadium, de gallium, du chrome (300 ppm), etc. Vers le toit on constate souvent un remaniement dans les premiers sédiments valdonniens, qui sont calcaires à l'Ouest des Baux, marneux ailleurs. -

Galets dans le miocène (helvétien sup...) languedoc
Quaternaire a répondu à un sujet de Kayou dans Géomorphologie, pédologie et géologie du quaternaire
@ esor, c'est en effet plus de ce côté la qu'il faut chercher je pense @Next, un climat= 1 pédogénèse, cela dit je crois que tu confonds le sol (paleosol) et les variations au sein de ce sol (diffrents horizons, differentes reprecipitation) donc dans ce dernier cas oui en theorie tu peux avoir des des zones differentes suivant les conditions de drainage par exemple. cependant tu as du "taper" trop vite tu voulais surement dire gibbsite et goethite non? Car bauxite= gibbsite + geothite+ autres -

Galets dans le miocène (helvétien sup...) languedoc
Quaternaire a répondu à un sujet de Kayou dans Géomorphologie, pédologie et géologie du quaternaire
Je rejoins Next, ce n'est aps de la bauxite. cette derniere est obtenue par precipitation des divers oxydes et hydroxyde d'aluminium (gibbsite) associcés à des oxydes de fer (geothite). C'est le resultat de la lixiviation des cations basiques et de la silice. Donc ce galet quartzeux ne devrait plus exister....lors de la formation de la bauxite -

Géologie du défilé de l'Inzecca (Corsica)
Quaternaire a répondu à un sujet de Next50MY dans Forum Géologie
Execellent -

Géologie du défilé de l'Inzecca (Corsica)
Quaternaire a répondu à un sujet de Next50MY dans Forum Géologie
Heinn...quoi !!!! j'ai entendu le mot messinien ici -

Les petits bassins Paléogènes de la région Nord-Varoise
Quaternaire a répondu à un sujet de Next50MY dans Forum Géologie
dans cette note on voit que malgré l'intérêt des mammifères pour la stratigraphie, rien ne vaut l'abondance de petites bêtes moins spectaculaires mais dont l'abondance permet d’affirmer ll'autochtonie. Pour les mandibules et autres ossements de mammifère, c'est une autre histoire...les remaniements de niveaux plus anciens sont plus que probables. Alors est ce que ces sables sont Stampien ou Sparnacien? Sur les crates géol c'est toujours indiqué en Sparnacien. -

Etrange formation rocheuse
Quaternaire a répondu à un sujet de Chicxulub dans Forum Fossiles et Paléontologie
pas d’œufs de dinos en tout cas.... Sur ton lien Next, certaines boules sont de grosses septaria a priori. -
Alain, c'est exactement le secteur ou j'etais aller voir pour chercher une analogie au Cap de Creus, voir ici: http://www.geoforum....360#entry340187 Duesroques, ce serait bien de nous donner des photos du faciès deltaïque du zanclean en dessous de la terrasse. Il est peut être possible de trouver dans ces terrasses des preuves de néotectonique (déformations, galets striés) Concernant la chronostratigraphie, les geologuedu quaternaire et les geomorphologue ont tres longtemps résonnés suivant les position altitudinales des terasses les unes par rapport aux autres. Puis suivant le schema des glaciations (europe au Nord) et des pluviaux -interpluviaux (Maghreb) ont leur attribuias un age (terasse Minedl par ex) sauf que rien n'est sur. Puisque l'on a longtem,ps sous estimé le facteur tectonique. Donc tant que l'on a pas une datation absolue suivant des methodes de radionucleides, l'age est a prendre avec précaution. En tout cas c'est un secteur très intéressant. Concernant la "terrasse", notons que tres souvent on parle de terrasse suivant sa définition geomorphologique, d'un point de vue géologique, tres souvent nous n'avons pas la terrasse entière. En effet, il y a deux unités, l'unité inférieure à éléments grossiers (galets) et une unité supérieure faite de limon et argile , cette dernière est dans le cas des terrasses anciennes très souvent décapée. Voici le détail e la carte geol: Fw. Alluvions de la très haute terrasse de Poe Calbeil—Mas Ferréol (Günz probable). Cette terrasse se réduit en fait à un chapelet de lambeaux épars jalonnant, entre Néfiach et Baixas, le contact du bassin du Roussillon et du massif de Força-Real—Calce. Les plus occidentaux de ces lambeaux scèlent le contact par faille de ces deux unités. Cette nappe résiduelle a subi concurremment altération et érosion, en sorte qu'elle est considérablement amaigrie, réduite en surface à une concentration d'éléments siliceux de grande taille, fragmentés, cariés, éolisés et patines. Le spectre initial de cailloutis (qui n'est autre que celui de la Têt) ne subsiste qu'à la base de la terrasse, souvent à la faveur de poches. Hormis les quartz ou les éléments siliceux, tous les autres galets ont subi une altération poussée. Il s'agit de la terrasse la plus haute, et donc la plus ancienne, du système de nappes étagées de la Têt. Son altitude relative est de 100 m, au droit de Poe Calbeil. Elle est postérieure à la brèche de Força-Real, d'âge zancléen supérieur, qui marque, latéralement, le sommet du remblaiement pliocène. On doit d'ailleurs remarquer qu'elle tronque cette formation en même temps qu'elle scelle la faille de bordure de Força-Real. Sa position relative vis-à-vis des niveaux qui lui sont subordonnés la place dans le Villafranchien et, vraisemblablement, dans le Gûnz.
-
Bonsoir vivien, si le couteau de géologue n'est pas son outil de travail à proprement parler (c'est plutôt le marteau), à part l'opinel, la laguiole ou le victorinox qui lui sert a couper son saucisson, il est vrai que le couteau est l'instrument de terrain avec la tarrière de base du pédologue. Avec celui ci, face a un profil de sol, le pédologue peu dans le desordre: "raffraichir" le profil de sol, c'est a dire pratiquer des petits prélèvements sur la face du profil pédologique pour obtenir une vue fraiche de celui ci (une brosse est aussi utile dans ce cas) appréhender la compacité des horizons étudiés couper les racines qui dépassent prélever des échantillons (agrégats) de sol Il n'y a pas de couteau typique, il doit avoir les caractéristiques suivantes: pointu, à lame rigide et solide. Les petits couteaux de chasseurs ou de boucher font l'affaire.
-

Comment une telle pierre peut-elle se former?
Quaternaire a répondu à un sujet de Hervé ALLARD dans Demandes d' identification de minéraux
Une explication qui tient la route avec en prime un SUPER dessin ... du GRAND art -
Les mécanismes sont ceux de la sédimentologie et de la géomorphologie appliquée aux zones d'estuaires ou se rencontre des eaux douces chargées en sédiments et des ondes de marées Les fluctuations des débits et donc de la charge en sédiments ainsi que les marées entraines des modifications des zones de sédimentations et d'érosions.
-
Oui, j'ai pensé à cela effectivement. On a l'air d’être régulièrement entre le marin et le continental, avec des variations de niveau d'eau plus proche de la 10aines de mètres , du coup on peux appliquer les outils et réflexions de la geologie ainsi que la morphopédologie du quaternaire à ces dépôts, ce dont tu parles est un exemple frappant et magnifique qui mériterait une parenthèse avec des photos et explications de textes...
-
je ne connais pas bien le BP ni les dépôts mais en regardant un peu je vois que c'est assez complexe en terme de paléogéographie et forcement en terme de facies changeant le tout probablement affecté par des paleosols. Donc, moi qui ne suis pas stratigraphe ni un connaisseurs de fossiles encore moins de gasteropodes, j'ai du mal a comprendre comment attribuer des ages certains a des facies aussi changeant entre eaux douces , saumatres et marines le continetal proche . Sachant que les premiers dépôts vont être érodés lors de la mise en place des seconds, j''magine le bo...l pour interpréter. par exemple on pouvait bien avoir une partie emergée, des rivieres avec du grossiers au fond et du fin dans les plaine inondables, aisni que des des estuaires marins. Du coup, on voit des succesions lithologiques qui ne sont en fait que synchrone. Est ce que vos coquillages ont été définis est datés dans des endroits ou on est sûr de la stratigraphie, parce que j'ai l'impression que la, on a l'inverse. a savoir des couches ou l'on trouves des coquilles, mais on ne connait pas bien la sucessions temporelles de ces couches (puisque cela varie entre l'est et l'ouest) et on se base sur les fossiles pour attribuer un age. Est ce que ce genre de correlation est vraiment valable?
-

galet bizarre !
Quaternaire a répondu à un sujet de esor6 dans Demandes d' identification de minéraux
même remarque a première vue... oui, ...mais dans le détail je doute. -

galet bizarre !
Quaternaire a répondu à un sujet de esor6 dans Demandes d' identification de minéraux
Ok, merci pour la précision je n'avais pas compris. L’hypothèse d'un poudingue sédimentaire est tombée à l'eau, comme le galet -

Comment interpréter ces cartes et coupes géologiques ?
Quaternaire a répondu à un sujet de ANDRE HOLBECQ dans Forum Géologie
d'après les documents fournis, je le répète je ne vois pas d'inversion par contre j’aimerais éclairer ceci: Donc, tu as constaté une inversion sur une coupe de terrain ) et non pas sur la coupe géologique fourni en pièces jointes, car cela change la problématique. est tu sûr de bien rattaché ton observation au bon faciès? As tu une photo? -

galet bizarre !
Quaternaire a répondu à un sujet de esor6 dans Demandes d' identification de minéraux
Comme es Je suis d'accord, cela n'as pas l'air d'être sédimentaire. -

Comment interpréter ces cartes et coupes géologiques ?
Quaternaire a répondu à un sujet de ANDRE HOLBECQ dans Forum Géologie
Salut, sur ta coupe J8b est bien au dessus de J8a. Je pense que ce que tu pense être une inversion, à partir de la lecture de la carte, n'est en fait que l'effet de l'érosion d'une partie de j8b qui laisse apparaitre j8a . Je connaissais le flan aux oeufs mais pas le cran aux oeufs... ..."cran" est un terme local qui veux dire quoi stp? merci -
Oui Next,d'autant plus que ce que je prenais pour de l'altération est peut être plus du lichen