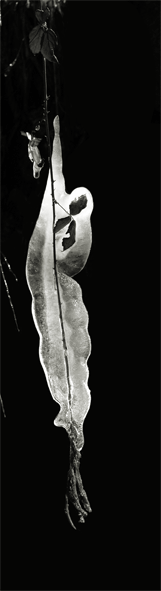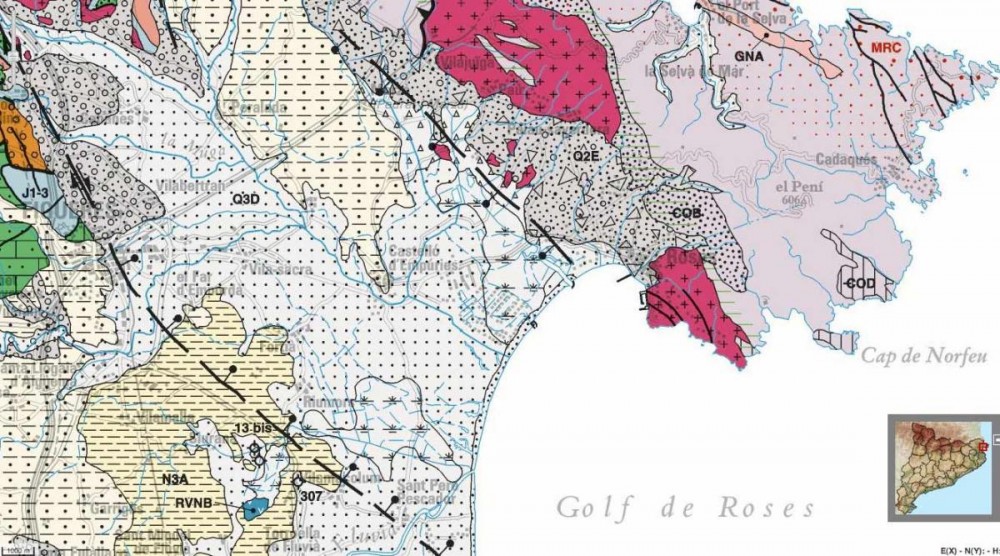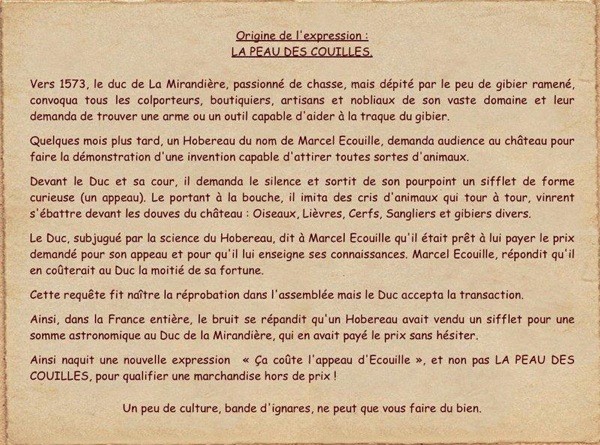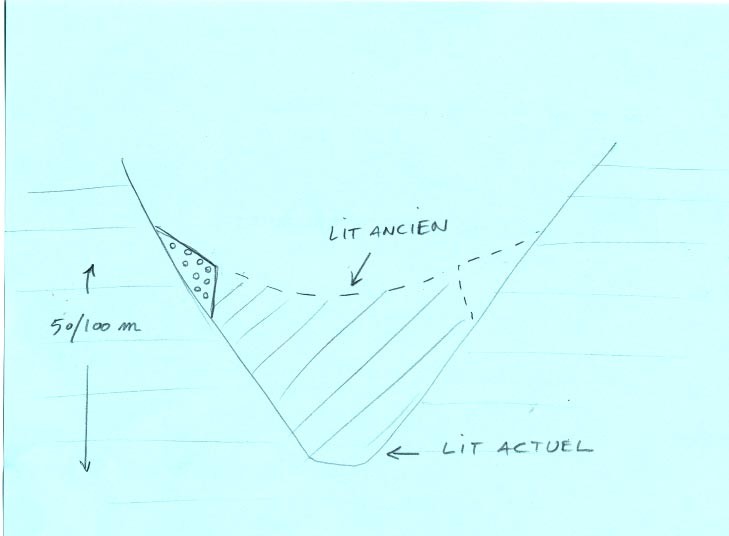Je reprend ton exemple pour plus de clarté :
LEGENDE:
p1delta. Faciès deltaïques : sables, graviers, galets. Latéralement, dans
les diverticules septentrionaux de la ria (en amont de Millas) aussi
bien que longitudinalement (en amont de Néfiach) lorsque le domaine
marin passe sous influence fluviatile, les indicateurs biologiques de
milieu marin se raréfient puis disparaissent en même temps que les
faciès détritiques accentuent leur caractère proximal.
Dans ce contexte spécifique de deltas sous-marins, seules les structures
sédimentaires — étayées éventuellement par le témoignage du
microplancton marin (Cravatte et al, 1984) — peuvent apporter la
preuve de l'ambiance marine du dépôt. On relèvera, à cet égard leur exceptionnelle amplitude.
Il faut également remarquer que dans ce domaine paléogéographique
de fond ou de bordure de ria, soumis à de gros apports détritiques, il
n'est pas toujours aisé de pointer avec précision le passage du marin
au continental.
Ici, la nature marine des couches Pliocène est validée uniquement par leur structure et quelque microfaune (même combat qu'au Cap !)
Il y a tout de même - en plus du sable - du gravier et des galets...
La pointe de ta flèche sur la carte géol doit se situer à 150 m. Les couches s'étendent jusqu'à un peu plus de 200m.
Côté espagnol, ont retrouve les mêmes formations marines Pliocènes, du côté de Rosas qui, elles, montent péniblement à 90 m. (voir carte géol Rosas jointe- N3A)
Alors que nos sables culminent autour de 150 m...
Il y a un truc là qui faudrait m'expliquer !
p1c. Faciès continental : limons et marnes concrétionnées. Abstraction
faite des recouvrements superficiels quaternaires, ce Pliocène
continental couvre toute l'étendue située au Sud-Est d'une ligne Millas—
Rivesaltes.
Cette formation continentale enregistre une double variation de
faciès, longitudinale d'une part (selon la direction de la Têt) et transversale
d'autre part (selon la direction méridienne). Cette dernière,
étant données ses très nettes délimitations cartographiques, a permis
d'introduire des subdivisions faciologiques (pBn et pBr2) correspondant
aux apports latéraux. L'évolution longitudinale des apports allochtones
est loin d'être aussi tranchée. Il s'agit globalement — au sein d'une
formation alluviale de piémont — d'une évolution progressive assurant
la transition entre les faciès proximaux d'amont, situés aux débouchés
des cônes (cailloutis grossiers d'Ille-sur-Têt), aux faciès distaux d'aval
(limons jaunes silteux marmorisés, niveaux de concrétions carbonatées,
etc.).
L'âge zancléen de cette formation continentale est prouvé par les
microfaunes de rongeurs qu'elle a livrées sur les trois feuilles limitrophes
à Terrats (Michaux, 1976 : feuille Céret), Villeneuve-de-la-
Raho (Mein et Aymard, 1984, 1985 : feuille Argelès-sur-Mer) et
enfin du Serrât d'en Vacquer, avec ses deux sites : batterie (Depéret,
1890) et château d'eau (Mein et Aymard, 1984, 1985; Michaux et
Aguilar, 1985). Il faut rappeler que ce site célèbre en paléontologie
(faune dite de Perpignan ou du Roussillon) se trouve à moins de
500 m de la bordure orientale de la carte (feuille Perpignan). Ces
trois gisements appartiennent aux biozones MN 14 de l'échelle de
Mein (Mein, 1975) et F de celle d'Aguilar et Michaux (Aguilar et
Michaux, 1984, 1987), équivalentes, l'une comme l'autre, au Zancléen.
Ici, le Zancléen continental est daté par de la faune terrestre (du solide).
Donc, je suppose que la formation marine précédente est confortée par ces datation.
Mais là encore, la seule valeur sûre est une datation sur du continental.