Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |
-
Compteur de contenus
7484 -
Inscription
-
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Blogs
Boutique
Tout ce qui a été posté par Théophraste
-
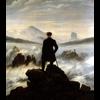
Problème archéologie : Réaction du quartz à haute température
Théophraste a répondu à un sujet de Wildcat dans Forum Minéraux et Minéralogie
personne pour aider ? -
isoler des autres minéraux, enfermer pourquoi pas, ceci dit, ce type d'objet est très très courant en France, rien de "précieux" si cela n'est les souvenirs qu'on peut y attacher, et il n'y a rien à faire pour stopper le processus en cours, la marcasite va plus ou moins vite tomber en "poussière"...
-
La marcasite va continuer à "sulfater", la "poudre blanche "qui se forme absorbe l'eau contenue dans l'air, et donner de l'acide sulfurique, qui va attaque tout ce qui se trouve aux alentours, en gros :)
-
Pour la marcasite, elle est perdue, rien à faire, elle a déjà trop "travaillé", attention à ne pas la mettre trop près si vous la gardez d'autres minéraux, notamment des carbonates (calcite, rhodocrosite) ou sulfures (galène, etc), la marcasite va acidifier son environnement et peut provoquer des réactions chimiques sur d'autres spécimens.
-
Les minéraux du Laurion, hum, vraiment bien, les rhodocrosite, les azurite, etc.
-
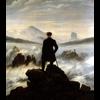
Problème de serveur, la connexion à Géoforum a échoué
Théophraste a répondu à un sujet de Méso dans Vie du forum géologique Géoforum
bon, pour l'émoticône coucou, aussi bien en tappant sont intitulé, qu'en allant charger son image dans la lsite des émoticônes, chez moi, çà marche... -
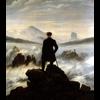
Problème de serveur, la connexion à Géoforum a échoué
Théophraste a répondu à un sujet de Méso dans Vie du forum géologique Géoforum
:coucou: -
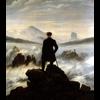
Problème de serveur, la connexion à Géoforum a échoué
Théophraste a répondu à un sujet de Méso dans Vie du forum géologique Géoforum
ah le coucou, c'est pas un soucis avec tous les émoticones, maus juste celui là :coucou: -
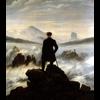
Problème de serveur, la connexion à Géoforum a échoué
Théophraste a répondu à un sujet de Méso dans Vie du forum géologique Géoforum
humm, les émoticônes s'affichent bien, lors de chaque publication de message, on a l'option "afficher les émoticônes", il faut que cela soit coché pour qu'ils s'affichent, sinon, c'est que l'on n'en veut pas dans ses messages... Pour l'avatar, en fait il n'y a plus qu'une seule image par membre pour personnaliser son profil dans la version en ligne depuis qq mois, l'admin peut choisir soit de prendre pour tout le monde les avatars, soit les photos, je n'avais pas jusqu'à ce matin compris qu'il fallait choisir, autant pour moi, j'ai là mis comme image de personalisation des profils/membres les avatars, plus de membre en ont... -
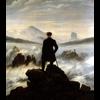
Problème de serveur, la connexion à Géoforum a échoué
Théophraste a répondu à un sujet de Méso dans Vie du forum géologique Géoforum
On va vérifier que tout passe bien aussi ds la galerie de photos et les blogs, n'hésitez pas à faire comme nous et à nous faire remonter des infos si soucis :). Comme dit rapidement, afin de mieux lutter contre de possible tentative de priatage ET de mieux pouvoir gérer les pics de connexion à la base de données qui la plante parfois, changement de système d'exploitation pour le serveur (un peu comme passer de windows xp à windows 7 sur un pc, un peu...), on sauvegarde tout (notamment les 200.000 photos qu'il y a ici !), on retire tout du serveur, et on change de système d'exploitation, puis on remet tout, il y a un certain nombre de réglages à remettre, faut penser à tout . -
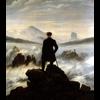
Problème de serveur, la connexion à Géoforum a échoué
Théophraste a répondu à un sujet de Méso dans Vie du forum géologique Géoforum
Merci à Stéphane pour ce "chantier" de changement de système d'exploitation du serveur surtout -
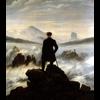
Problème de serveur, la connexion à Géoforum a échoué
Théophraste a répondu à un sujet de Méso dans Vie du forum géologique Géoforum
-
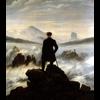
Problème de serveur, la connexion à Géoforum a échoué
Théophraste a répondu à un sujet de Méso dans Vie du forum géologique Géoforum
Hello Stéphane, j'avais pas vu que tu étais sur l'admin aussi. -
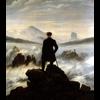
Problème de serveur, la connexion à Géoforum a échoué
Théophraste a répondu à un sujet de Méso dans Vie du forum géologique Géoforum
-
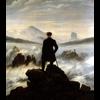
Réapparition rapide des récifs après l'extinction de masse du Permien
Théophraste a répondu à un sujet de Théophraste dans Forum Fossiles et Paléontologie
c'est une com' avant publication cnrs, Stéphanosaurus_Jeannellus a mis le lien vers l'article complet. -
Une réapparition rapide des récifs après l'extinction de masse du Permien. Après l'extinction qui a marqué la fin de l'ère primaire, il y a 252,6 millions d'années, les récifs à animaux multicellulaires ont mis moins de deux millions d'années pour réapparaître et se diversifier. Jusqu'à présent, on pensait que ce temps de récupération avait été d'une dizaine de millions d'années. Ces résultats ont été obtenus par une équipe internationale menée par quatre chercheurs français du laboratoire Biogéosciences (CNRS/Université de Bourgogne) et du Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, planètes et environnement (CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/ENS Lyon). Ils seront publiés le 1er octobre dans la revue Nature Geoscience. Il y a 252,6 millions d'années, la Terre traverse la plus grande extinction de masse jamais enregistrée : la crise permo-triasique(1). Plus de 90% des espèces existant alors disparaissent brutalement, notamment dans les océans, laissant une biosphère dévastée qui mettra 10 à 30 millions d'années avant de retrouver une biodiversité comparable à celle d'avant la crise. A l'appui de ce scénario « d'écocide(2) global », de nombreux enregistrements sédimentaires et géochimiques attestent de perturbations environnementales majeures durant l'ensemble du Trias inférieur (les cinq millions d'années qui suivent l'extinction de masse) : cycle du carbone anormal ; océans acides, appauvris en oxygène et enrichis en gaz carbonique et en sulfures. D'après le consensus auquel la communauté scientifique est parvenue après un demi-siècle de recherches, les havres de diversité marine que sont les récifs, disparaissent durant tout le Trias inférieur. A leur place se développent des dépôts massifs de carbonates d'origine exclusivement microbienne appelés microbialites, témoins d'écosystèmes dépourvus d'organismes multicellulaires. En 2009, un groupe franco-suisse a remis en cause ce paradigme de « rediversification lente et retardée » en montrant que, suite à l'extinction permo-triasique, la diversité des ammonites avait réaugmenté 10 à 30 fois plus rapidement que ce qu'on estimait jusqu'alors(3). Aujourd'hui, la même équipe met en évidence la réapparition rapide – à l'échelle des temps géologiques, soit après 1 à 2 millions d'années – de récifs à animaux multicellulaires (métazoaires). Pour arriver à ce résultat, plusieurs années d'exploration méthodique des vallées du Sud-Ouest des Etats-Unis (Utah, Nevada et Californie) ont été nécessaires. De ces observations de terrain doublées d'une étude microscopique de centaines d'échantillons rapportés en laboratoire, deux informations ressortent : à plusieurs endroits et à plusieurs moments durant le Trias inférieur se sont développés des récifs formés par l'association de microbes et d'éponges de morphologies et de tailles variées. Ces récifs abritaient une faune diversifiée comprenant, entre autres, des foraminifères, des serpules, des gastéropodes, des bivalves, des ammonites, des ostracodes, des brachiopodes, des échinodermes et des conodontes. Le rétablissement rapide de récifs à métazoaires diversifiés dès le début du Trias inférieur relance le débat sur les rythmes et les modalités de la rediversification biologique consécutive à la crise permo-triasique. Si on sait mieux comment se déclenche une extinction de masse, la façon et la vitesse à laquelle la biosphère récupère et se rediversifie après une telle crise demeure toujours mal comprise. Notes 1. Du nom des deux périodes géologiques qui l'encadrent, le Permien (299 - 252,6 millions d'années) et le Trias (252,6 - 201,6 M.a.), cette crise marque la fin de l'ère primaire, ou Paléozoïque, et le début de l'ère secondaire, ou Mésozoïque. Elle est probablement liée à une intense activité volcanique en Chine et en Sibérie. 2. Un écocide (néologisme construit à partir des mots "écosystème" et "génocide") est la destruction (naturelle ou anthropique) systématique et totale d'un écosystème. 3. Voir Brayard et al. (2009 - Science, 235 : 1118-1121) et le communiqué de presse associé. Références Transient metazoan reefs in the aftermath of the end-Permian mass extinction, Arnaud Brayard, Emmanuelle Vennin, Nicolas Olivier, Kevin G. Bylund, Jim Jenks, Daniel A. Stephen, Hugo Bucher, Richard Hofmann, Nicolas Goudemand & Gilles Escarguel. Nature Geoscience. Article à paraître le 1er octobre 2011 en version papier (En ligne le 18 septembre). Auteur CNRS.
-
Les vastes plaines arctiques de Mercure ont été formées par de gigantesques coulées de lave. D’immenses coulées de lave ont formé les vastes plaines autour du pôle nord de Mercure, selon une recherche qui pourrait aider à expliquer la formation et l’évolution de la plus petite et mystérieuse planète du système solaire. Cette conclusion, qui confirme ce que les astronomes supputaient, est basée sur des observations et mesures de la sonde américaine Messenger placée sur l’orbite de Mercure en mars. Ces plaines intriguaient les chercheurs depuis le premier survol de Mercure effectué par la sonde américaine Mariner 10 en 1974 qui les avait photographiées pour la première fois. Ces longues étendues, épaisses d’un kilomètre à certains endroits, sont le résultat d’une importante activité volcanique qui a produit des torrents de lave il y a un peu plus de 3,5 milliards d’années. Elle recouvrent 6% de la superficie de Mercure, soit l’équivalent de 60% de la surface des Etats-Unis. "Pendant plus de 35 ans nous n’étions pas pas sûrs du rôle de l’activité volcanique sur Mercure", observe James Head, professeur de géologie à l’université Brown (Rhode Island, nord-est), et co-auteurs de ces travaux publiés dans Science datée du 30 septembre. Tôt dans l’histoire de la planète -- il y a de 3,5 à 4 milliards d’années-- d’énormes volumes de lave se sont déversés par les fissures à la surface de Mercure, recouvrant les plaines basses, explique ce géologue. Ces coulées de lave ont rempli des cratères de plus d’un kilomètre et demi de profondeur, ajoute-t-il. Cette lave "n’a pas formé des cônes volcaniques comme à Hawaii mais recouvre à plat les endroits où elle sort du sol, ce qui rend ce phénomène très difficile à comprendre dans le contexte des éruptions volcaniques que nous observons sur la Terre", remarque le scientifique. "Ces observations nous donnent d’importantes indications sur ce qui se passe à l’intérieur de Mercure", renchérit Jennifer Whitten, membre de l’équipe du Pr Head. Selon James Head, les coulées de lave fournissent aux scientifiques des indices sur la manière dont sont nées les planètes, leur évolution et si elles sont encore actives. "Sur la Lune par exemple, nous observons très peu de signes d’activité volcanique au cours des deux à trois dernières milliards d’années", note-t-il.
-
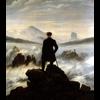
Exploitation du gaz de mine
Théophraste a posté un sujet dans Mines, carrières et industrie minérale
Le grisou, encore présent en grandes quantités dans les anciennes mines de charbon, intéresse de plus en plus les producteurs d’énergie. Aux Etats-Unis, mais aussi en France, il est déjà exploité à l’échelle industrielle et pourrait aussi l’être un jour en Wallonie. Mieux encore : l’exploitation du gaz de mine peut se combiner à la séquestration de CO2 dans le sous-sol. http://trends.levif.be/economie/actualite/dossiers/le-gaz-naturel/gaz-de-mine-une-future-ressource-pour-la-wallonie/article-1195111531951.htm -
La Chine et l'Afrique du Sud signent des accords de coopération dans les domaines des ressources minérales et des finances. La Chine et l'Afrique du Sud ont signé mercredi deux accords sur la coopération dans les domaines de la géologie, des ressources minérales et des finances, à l'occasion de la visite du vice-président sud-africain Kgalema Motlanthe en Chine. Un mémorandum d'entente sur la coopération en matière de géologie et des ressources minérales et un accord sur le développement de la coopération financière ont été signés à l'issue de la rencontre entre le vice-président chinois Xi Jinping et son homologue sud-africain Kgalema Motlanthe à Beijing. Selon le mémorandum d'entente, la coopération se concentrera sur la géologie, et la gestion durable, l'utilisation et le développement des ressources minérales dans les deux pays, sur la base de bénéfices mutuels. Un accord signé entre la Banque de développement de Chine et la Banque de développement d'Afrique du Sud stipule que les deux banques accorderont un soutien financier à la coopération bilatérale dans les domaines de la construction d'infrastructures, des transports, de l'utilisation des ressources en eau, des logements, de la santé et de l'éducation. En qualifiant de "grand bond en avant" le développement des relations bilatérales depuis dix ans, Xi Jinping a déclaré que la Chine et l'Afrique du Sud devaient s'unir et promouvoir leur partenariat stratégique global dans les dix années à venir. La Chine et l'Afrique du Sud ont établi un partenariat stratégique global en août 2010. Par ailleurs, le président chinois Hu Jintao et le Premier ministre Wen Jiabao devraient s'entretenir avec M. Motlanthe à Beijing, deuxième étape de sa tournée en Chine qui devrait s'achever vendredi. Avant d'arriver à Beijing, il a déjà visité la ville de Shanghai (est). Agence de presse Xinhua / 2011/09/29.
-
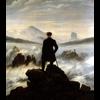
Mais où est passé 1frangin ???
Théophraste a répondu à un sujet de me262 dans Y'a pas que les Sciences de la Terre dans la vie...
coucou aux clubs des "3" :). -
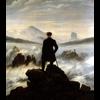
Nouvelle catégorie "naturaliste"
Théophraste a répondu à un sujet de José el Français dans Foire aux questions du forum de géologie Géoforum
coucou, je suis même si je dis rien, je laisse avancer la discussion sans perturber les échanges par un avis perso trop vite avancé :), suis pas contre ,ceci dit, "on" m'a et "on" me reproche parfois qu'il y a trop de sous espace, qu'en pense les autres ? Si + d'avis positif, on y va . -
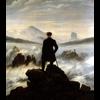
Problème de serveur, la connexion à Géoforum a échoué
Théophraste a répondu à un sujet de Méso dans Vie du forum géologique Géoforum
Coucou, les émoticônes apparaissent sous le zone de frappe des textes, si on clique sur l'option (la tête qui sourie là au dessus, à drotie de police et taille...) -
Impressionnant !
-
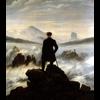
Calcite + Rhodochrosite ? (Couillet ?)
Théophraste a répondu à un sujet de Cyclopkilouch dans Demandes d' identification de minéraux
Hello, couillet, c'est une carrière en Belgique non ? Un lointain souvenir de sortie . Pas de rhodocrosite, calcite coloré en rougé par les oxydes de fer et autres. -
up! Les minéraux du Gabon.




